Jérôme et Robin avec leur fils Paul à Courchevel. Photos © Jean-Luc Mège
Propos recueillis par Pascal Auclair
A Collonges pour souffler les 90 bougies de son père, Jérôme Bocuse est aussi de plus en plus présent à Lyon depuis qu’il a pris le contrôle du groupe familial. Un nouveau challenge à relever pour le fils prodigue de « Monsieur Paul », dont la vie se partage désormais entre les États-Unis et la France. Pour Lyon People, entre deux descentes sur les pistes de Courchevel, il évoque cette nouvelle aventure, ses intentions pour l’entreprise familiale et son affection pour son papa.
LP : Vous avez pris tout le monde à contre-pied en rachetant la participation minoritaire de Naxicap Partners, filiale de Natixis. Regrettez-vous cette décision ?
JB : Non, pas du tout. Cela dit, cinq ans plus tôt, si on m’avait demandé de revenir en France, j’aurais sans doute dit non. Mais la rencontre de Paul-Maurice Morel et l’affaiblissement de mon père ont fait évoluer ma vision des choses, d’autant qu’il n’a jamais vraiment souhaité l’entrée d’un fond d’investissement dans les brasseries. À l’époque, il l’avait fait à contrecœur. Il était donc important que je m’implique personnellement afin de faire évoluer le groupe comme mon père le souhaitait, avec sa vision, son ADN. La famille, avec un grand F.
Un remake de Au nom du père…
Oui, c’est un peu ça !
Un an et demi après avoir repris le contrôle du groupe, estimez-vous parfaitement maîtriser son environnement économique ?
Oh non, il me reste beaucoup à apprendre. J’avais 20 ans quand je suis parti aux USA. Je n’ai travaillé qu’aux États-Unis. Je découvre le monde du travail à la française. C’est à la fois un apprentissage et un challenge.
Vous découvrez donc la complexité, la lourdeur de ce monde du travail et de la législation française…
(Sourire) C’est vrai qu’aux États-Unis, c’est un autre système, plus libéral, plus incitatif… Là-bas, on donne l’occasion aux gens de travailler et ils savent pourquoi ils se lèvent chaque matin. En France, j’ai toujours l’impression qu’il faut les pousser, être en permanence derrière. Les Américains ont envie de gagner de l’argent pour s’offrir une belle maison, une piscine, une grosse voiture… Les Français pensent aux 35 heures, aux RTT.
« Le rêve américain existe encore. Je ne suis pas persuadé qu’il existe encore un rêve français ! »
Aujourd’hui, à la tête du groupe Bocuse, vous êtes plus dans l’observance ou dans l’opérationnel ?
Je suis encore dans l’observance. Paul-Maurice est là pour gérer l’opérationnel au quotidien. J’ai une philosophie, une méthode de travail importée des Etats-Unis. Je suis là pour donner une impulsion.
Justement, comment envisagez-vous votre rôle au sein du groupe ?
À terme, ce sera un rôle de leader. Que les équipes soient motivées, prennent plaisir à venir au travail. On partage tous la même aventure. Il suffit de ramer dans le même sens…
Malgré tout, cela vous paraît-il possible de concilier ce rôle de leader avec vos fonctions aux Etats-Unis ?
Oui, je pense. Les technologies rapprochent les deux continents. Je pense venir une à deux fois par mois. Cela devrait être suffisant.
Ne craignez-vous pas de devenir schizophrène avec un pied à Lyon et l’autre 0 Orlando ?
Oh non. Beaucoup de chefs d’entreprise français sont dans mon cas. Tout seul, on n’est pas grand chose. L’essentiel, c’est de bien s’entourer. Dans le groupe, que ce soit au niveau des chefs ou des managers, on est presque tous de la même génération. Ça aide. Et comme je suis quelqu’un de très entier, on peut dialoguer, se dire les choses droit dans les yeux. C’est une force.
Vous n’avez pas le même mode de management que votre père ?
On a une même philosophie. Lui aussi a toujours eu le souci de bien s’entourer, que ce soit avec des Meilleurs Ouvriers de France, des directeurs et des managers compétents. C’est ce qui nous rapproche. En revanche, on a des modes de management différents. Le code du travail, la législation ont changé. Il y a trente ou quarante ans, on dirigeait une équipe en cuisine à coups de pied aux fesses. C’est fini, ça. Aujourd’hui, il faut utiliser d’autres méthodes de management. Autres temps, autres mœurs…
Vos choix professionnels ont-ils fait ou font-il encore l’objet de discussions en famille ?
Oui, bien sûr. Cela dit, c’est le fruit d’un concours de circonstances, comme quand j’ai quitté la France pour les États-Unis à l’âge de 20 ans. A l’époque, je suis parti pour faire un petit stage dans un restaurant à Epcot en Floride et quelques années plus tard, j’en ai pris la direction. Aujourd’hui, je fais un peu le chemin inverse. Ce n’était pas prévu, ni voulu. Mais ça a un sens.
La dégradation de l’état de santé de votre père a-t-il accéléré les choses ?
Oui, bien sûr. Il est moins vaillant. Mais d’autres paramètres ont aussi influé sur ma décision…
Quelles valeurs vous a-t-il inculquées ?
La simplicité, l’humilité, la faculté de rester le même en toute circonstance. Il est parti de rien et malgré sa réussite, il n’a pas changé. Malgré son aura, il est toujours resté proche des gens, un peu « paysan » dans l’âme, au bon sens du terme.
Le fait de porter son nom est-il un atout ou un fardeau ?
C’est à double tranchant. Cela permet d’ouvrir plus facilement certaines portes mais on vous attend aussi au tournant…
Aujourd’hui, le groupe Bocuse est-il toujours dans une stratégie de croissance externe ou au contraire pourrait-il céder certains de ses établissements ?
Dans un premier temps, l’objectif est de stabiliser le groupe, de ne pas aller trop vite. Maintenant, il y a de nouvelles échéances proches. On travaille notamment sur l’ouverture de la brasserie Bocuse au Grand Stade, en septembre prochain. On a conçu ce dossier par affection pour Jean-Michel Aulas, un homme que je respecte beaucoup, qui a pris de gros risques avec le stade. Il y avait un sens à partager un tel risque avec lui, même si c’est loin d’être gagné. On va vivre ensemble une nouvelle aventure. On fera tout pour que ça marche. En attendant de pouvoir l’exploiter pleinement à l’automne, c’est C-Gastronomie qui assure les repas les soirs de match.
D’autres perspectives ?
Un ou deux autres projets pourraient émerger dans les années à venir, mais le but n’est pas de faire de la croissance à tout prix. La priorité reste de proposer une cuisine de qualité.
Et le Grand Hôtel-Dieu ?
On va voir. Pour l’instant, rien n’est signé. Je suis perplexe. On dispose de peu d’informations sur le site. Toute annonce serait prématurée.
Êtes-vous régulièrement sollicité pour ouvrir d’autres établissements ?
Oui, surtout aux Etats-Unis. J’ai au minimum un coup de fil par mois. Mais je reste les pieds sur terre. Rien n’est jamais acquis. Cela ne m’empêche pas d’aller de l’avant.
Vous voyez-vous un jour revenir définitivement en France ?
Non !
Pourquoi ?
Parce que j’ai ma vie aux États-Unis, même si c’est loin d’être le monde idéal. Il y a des bons et de moins bons côtés. Mais le monde idéal, il est peut-être justement entre les États-Unis et la France. Je suis fier de représenter la France de l’autre côté de l’Atlantique, de montrer un petit échantillon de la culture et de la gastronomie française à tous ceux qui viennent manger dans nos établissements.
Mais n’est-il pas frustrant de faire tous les jours de la cuisine à des Américains qui ne connaissent rien à la gastronomie ?
Non, au contraire. C’est très valorisant de leur faire découvrir les subtilités de notre cuisine. Ils n’ont pas toujours le sens du goût, ne connaissent pas les plats en sauce. Leur culture, c’est le steak que l’on cuit et retourne deux fois sur un grill. Nous leur enseignons l’histoire de nos plats, leur saisonnalité, l’alliance avec les vins de nos régions… On a une approche éducative.
Quel est le best-seller des plats servis à Epcot ?
La soupe à l’oignon et les escargots, dont la persillade se rapproche du garlic bread, ce pain à l’ail apprécié des Américains.
Loin des yeux, loin du cœur… Avez-vous gardé des attaches fortes à Lyon ?
Bien sûr. J’ai toujours mes copains d’enfance, mon Trompette avec qui j’ai fait l’armée, que je croise une ou deux fois par an. Il y a aussi Pierre-Guy Cellerier, Renaud Charrin, Hervé Durozard…
Et parmi les chefs ?
Mathieu Viannay, Christophe Marguin, les chefs du Bocuse d’Or. Mais quand je suis à Lyon, je suis plus souvent dans mes brasseries que chez les autres !
Quel chef lyonnais vous inspire de l’estime, voire de l’admiration ?
Mathieu Viannay. Il a de solides bases classiques mais a su faire évoluer sa cuisine. Il a un esprit d’ouverture, une qualité d’adaptation qui m’a impressionné lors de nos nombreux voyages ensemble, dont récemment au Japon.
Et la nouvelle génération ?
Il y a du potentiel… Il y a quelques semaines, je me suis régalé chez Christophe Roure (Le Neuvième Art). Ça pousse derrière. Il le faut. C’est bien.
Lequel vous paraît le plus apte à prendre un jour le relais de votre père dans le costume d’ambassadeur de la cuisine lyonnaise ?
(…) Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous voyagez beaucoup pour votre métier. Quelles sont les prochaines tendances en matière de cuisine ?
C’est vrai que la cuisine réagit de plus en plus aux phénomènes de mode. Qui aurait pu imaginer que des chaînes de sushis fleuriraient un jour aux quatre coins de Lyon… C’est tellement loin de la culture lyonnaise. Moi, je reste fidèle aux classiques. Comme en musique, c’est le meilleur moyen de n’être jamais démodé…
Quels sont vos « classiques » préférés ?
Une bonne blanquette de veau ou un poulet au vinaigre, avec une salade lyonnaise en entrée et une tarte aux pommes au dessert.
Pouvez-vous nous certifier que le Sirha (Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation) sera encore à Lyon en 2021 ?
Le Sirha est un événement made in Lyon difficilement transférable. En revanche, on est en train de décliner des mini Sirha un peu partout à travers le monde, le but étant de donner un échantillon de la grande fête de la gastronomie et les inciter à venir à Lyon.
« Le Sirha restera à Lyon quoi qu’il arrive. J’en prends l’engagement »
Et l’Auberge de Collonges, sera-t-elle un jour transformée en musée ?
Non. Mon père a bien fait les choses. Une structure a été mise en place avec trois MOF (Meilleurs Ouvriers de France). Christophe Muller va prendre encore du galon pour devenir le chef exécutif du groupe, que ce soit de l’Auberge ou des brasseries. Chacun est à sa place, chacun sait ce qu’il doit faire. On est en osmose.
Votre père vient de souffler ses 90 bougies. Est-ce un des moments les plus intenses que vous ayez vécus ?
Oui, forcément. Voir son père atteindre cet âge, c’est toujours émouvant. J’aurais préféré qu’il y arrive dans de meilleures conditions. Avec le Parkinson, ce n’est pas évident. Mais c’est la vie. On ne choisit pas. C’est déjà bien d’arriver là.
Vous êtes fier de votre papa ?
Oui, bien sûr.




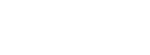







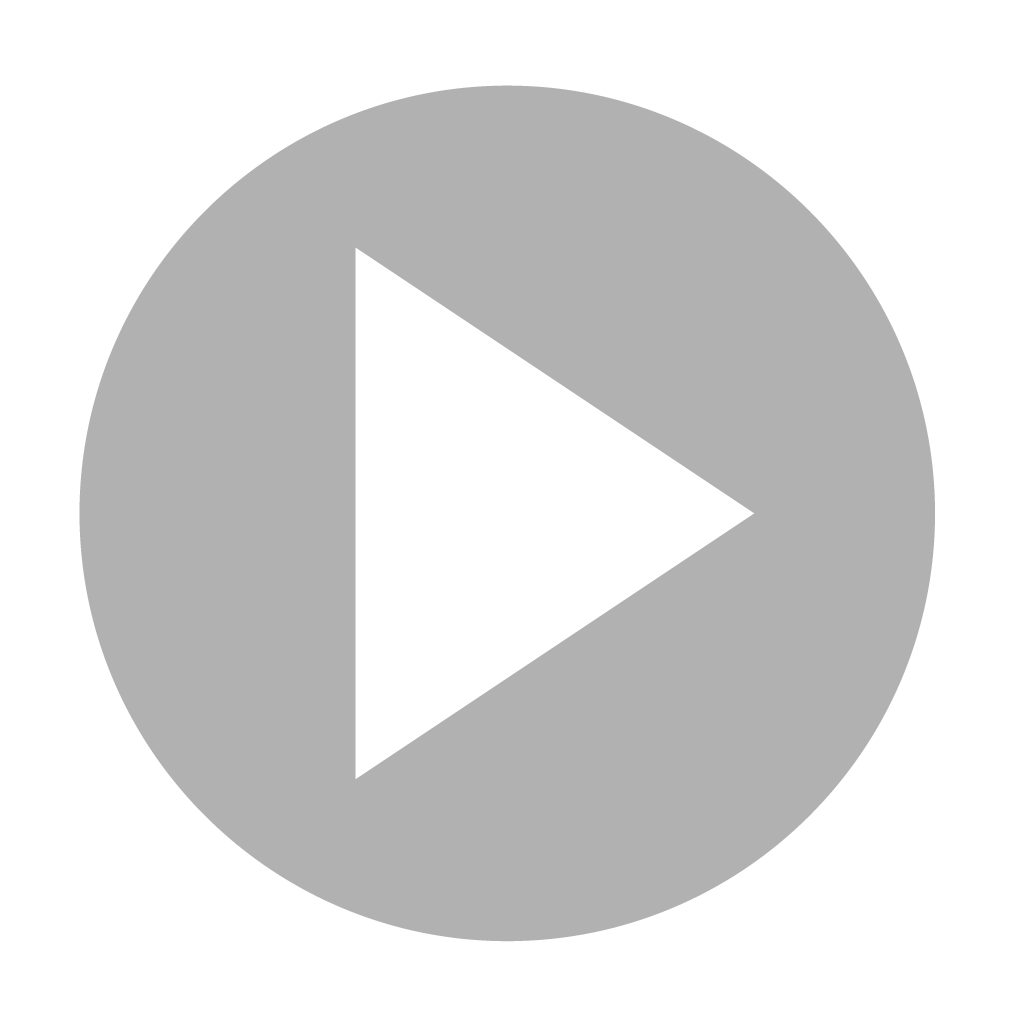

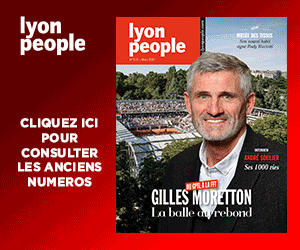







0 commentaires