 Par Aymeric Engelhard
Par Aymeric Engelhard
Applaudi à Sundance et primé au festival international du film fantastique de Paris (PIFFF), « Bellflower » est la curiosité indé US du moment. Cette œuvre au charme troublant a eu l’honneur d’être présentée en avant-première au Comoedia. Ce fut l’occasion de découvrir un film façonné entre potes non exempt de défaut mais profondément envoûtant. Une véritable petite surprise.
Une « muscle car » Buick Skylark ’72 dérape au ralenti dans une tornade de poussière. Le soleil fait fumer le macadam autour de la bête. Elle se nomme Médusa et c’est une créature qui nous brûle la rétine jusqu’à nous paralyser telle la virginale grecque qui tenta de séduire Poséïdon avant de subir la malédiction des dieux. Elle constitue l’objet de désir et de passion de Woodrow et Aiden, deux chevronnés qui ne jurent que par la fascination qu’ils éprouvent envers l’apocalypse selon « Mad Max 2 ». Jusqu’à créer eux-mêmes un lance-flamme ainsi qu’une voiture dans le plus pur style de l’Interceptor. Malheureusement si l’apocalypse aura réellement lieu ce n’est en aucun cas comme ils l’avaient espéré. Un chaos profondément humain aura raison d’eux : l’amour. Woodrow tombe amoureux de Milly, une casse-cou dans laquelle il se retrouve, et après une courte mais intense love story le chevronné se retrouve cocu. Anéantissement total. Dans une banlieue absolument pas reluisante de Californie, la destruction morale comme physique prend le pouvoir, les rêves madmaxiens restant des rêves, la violence de la réalité étant plus forte que tout. Sur un script entamé justement après une douloureuse séparation, le réalisateur Evan Glodell montre une maturité de cinéaste étonnante pour un premier film. Si son scénario manque souvent de panache, l’intelligence des images donne une réelle personnalité à l’œuvre. Misant sur une mise en scène minimaliste, Glodell se concentre sur l’essentiel, utilisant de longues focales et concentrant sa netteté sur les personnages afin de les entourer de flou.
Visuellement « Bellflower » est une tuerie. Glodell a modifié lui-même diverses caméras pour donner une véritable identité visuelle à son long-métrage. Ainsi la photographie vire la plupart du temps vers un jaune saharien extrêmement saturé. De plus l’optique des caméras se voit souvent recouvertes de poussière, traces de doigts et autres saletés totalement assumées. Pari osé mais diablement réussi. Tellement beau qu’on en oublierait presque les défauts dommageables du métrage. Le scénario aurait ainsi fait le bonheur d’un bon moyen-métrage. Ici le film s’étire constamment, jouant sur des flash-backs et des scènes imaginées. Tout semble bon pour rajouter quelques minutes au time-code final, jusque dans le générique. Certains personnages n’ont pas eu droit à un traitement aussi intelligent que les deux protagonistes principaux. Milly est ainsi absolument insupportable au point qu’on ne comprenne jamais pourquoi Woodrow la désire autant et les dernières scènes de Courtney, bien que fortes et bénéficiant d’une excellente interprétation de Rebekah Brandes, semblent sortir de nulle part. Ce sont les petits écarts d’un film embrasant, qui trouve ses plus beaux moments en dehors de l’histoire finalement. Tous ces plans mettant en scène la voiture crachant des flammes sur les routes désertiques ou dans la nuit noire au son de l’extraordinaire score de Jonathan Keevil resteront ancrés dans les mémoires. Cela faisant de « Bellflower » un « Mad Max » poétique.




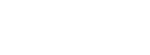







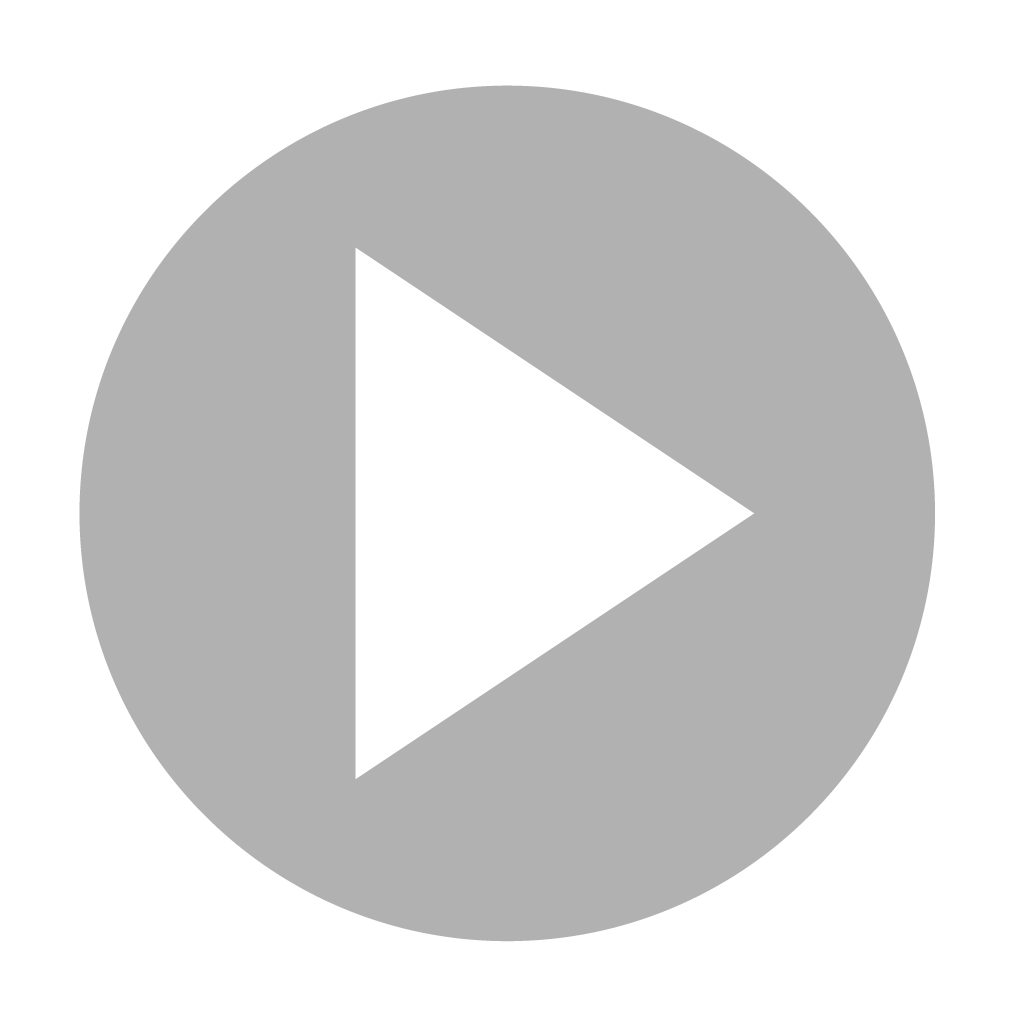

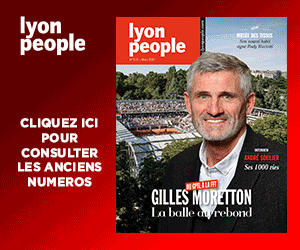







0 commentaires